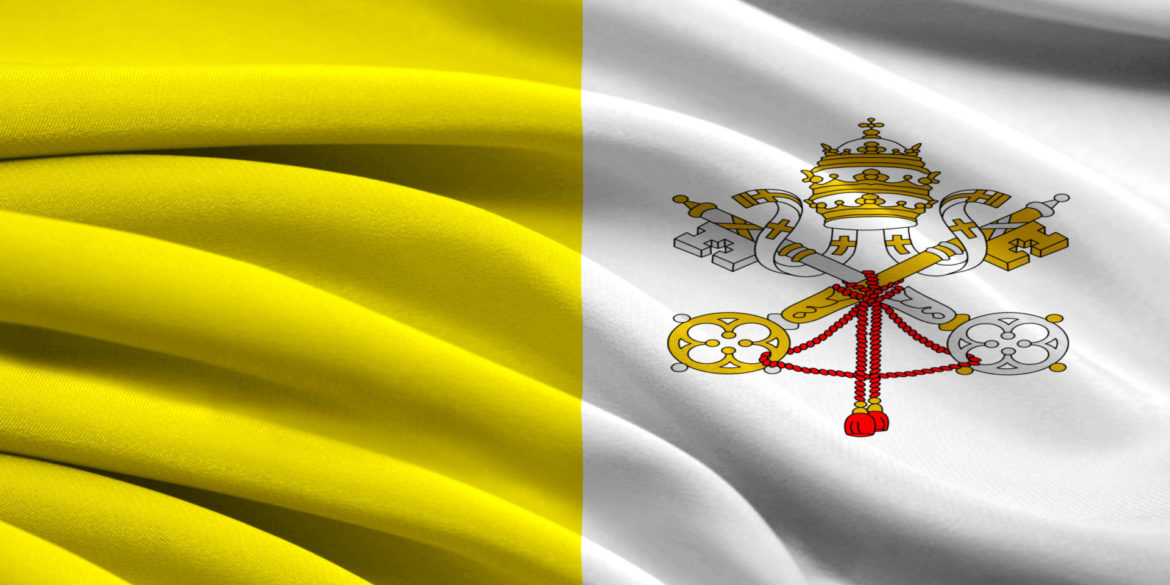La mort du pape François soulève quelques questions sur l’avenir immédiat de l’Église catholique. Nous ne savons pas exactement s’il s’agira d’une église véritablement connectée à ses paroissiens ou d’une église destinée à servir les intérêts d’une élite religieuse autoexclue des grands enjeux sociaux.
Le Vatican, un acteur actif sur la scène internationale dont l’influence tend à décliner
Certainement, le Vatican n’est pas un État-Nation au sens strictement géopolitique du terme. Le Saint-Siège a, en vertu du droit international, une définition juridique, théologique et politique venue du droit canonique, qui le constitue comme une entité indépendante, souveraine et autonome dans un périmètre de Rome qui ne dépasse pas un demi kilomètre carré. Cependant, sa fondation en tant qu’État remonte à 1929 avec la signature des Accords du Latran entre le Saint-Siège et le Royaume d’Italie . Depuis lors, le Pape exerce les fonctions de chef d’État et représente donc également le pays au niveau international par l’intermédiaire d’ambassadeurs pontificaux accrédités dans le monde entier sous le titre de Nonce apostolique. En effet, le Saint-Siège entretient actuellement des relations diplomatiques avec plus de 180 pays et diverses organisations internationales.
De cette façon, la diplomatie vaticane s’insère dans le cadre juridique international, en garantissant que sa mission contribue non seulement à renforcer la raison d’être de l’Église, mais aussi, à travers cette même mission, à ce que l’Église puisse servir d’instrument de paix, de dialogue politique et interculturel et de conciliation entre les États, indépendamment de leurs croyances. Il existe des exemples importants qui illustrent l’importance du rôle de l’Église dans la médiation internationale, notamment sa participation à l’arrêt de la course aux armements, son soutien vigoureux aux programmes de l’UNESCO promouvant l’éducation et la préservation du patrimoine mondial, la lutte contre les pandémies sous la direction de l’OMS, et sa facilitation de la transition qui a eu lieu en Europe avec la chute du mur de Berlin et la fin du bloc soviétique, sous le leadership du pape Jean-Paul II.
Cependant, l’histoire contemporaine a révélé un déclin du Saint-Siège dans la sphère géopolitique, non seulement en raison des scandales sexuels de plusieurs de ses représentants et des nombreux cas de corruption, mais aussi en raison de l’indifférence et du manque de visibilité de ses autorités face aux conflits majeurs et à la violation des droits de l’homme. Rappelons que les papes Pie XI et Pie XII, par exemple, ont été largement critiqués pour ne pas avoir condamné les crimes des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.
François, pape réformateur ou révolutionnaire ?
Le 13 mars 2013, l’Argentin Jorge Bergoglio a été élu successeur du pape Benoît XVI, devenant ainsi le premier pape jésuite et latino-américain. Son style a suscité dès le début une grande controverse au sein de la gouvernance du Vatican, car il a adopté une liturgie beaucoup plus simple et moins solennelle, qui a fait l’objet de critiques internes pour avoir considéré que cela réduisait la nature protocolaire et cérémonielle de la doctrine ecclésiastique.
François a adopté des positions ouvertes sur la question de l’homosexualité. Il a cependant soutenu que les unions entre personnes de même sexe ne devraient pas être considérées comme des mariages car, selon lui, cela constituerait « une tentative de détruire le plan de Dieu ». Il était également favorable à l’incorporation des femmes dans la Curie romaine. La nomination de Sœur Raffaella Petrini comme présidente de la Cité du Vatican et de Simona Brambilla comme préfète du Vatican à la place d’un cardinal a représenté une révolution au sein des structures administratives et de gouvernance du Vatican. En revanche, il était intransigeant sur l’avortement et le célibat des prêtres.
Par conséquent, nombre de ses réformes représentaient une révision audacieuse de certaines traditions qui étaient intouchables pour les secteurs les plus conservateurs de l’Église. D’autre part, François s’est débarrassé de toutes sortes de luxes et d’excès, en mettant en œuvre des politiques d’austérité. Ses quatre encycliques contenaient des messages beaucoup plus directs et profonds, chargés d’humilité sur la foi chrétienne, qui contribuèrent à l’expansion de l’Église et à l’augmentation des paroissiens catholiques.
Une personnalité médiatique majeure
La personnalité du pape François a sans aucun doute été un élément clé dans son approche du peuple et dans la projection de son leadership international. François fut également le pape qui proclama le plus de saints dans toute l’Église, avec 942 canonisations. Ces éléments, combinés à ses nombreuses interviews et apparitions publiques, font de lui sans aucun doute l’une des personnalités les plus médiatiques de l’histoire.
Mais si nous analysons sa gestion diplomatique, nous constatons que le pape François et le Vatican dans son ensemble n’ont pas réussi à jouer un rôle plus décisif, belliqueux et de premier plan dans les conflits majeurs, tant au Moyen-Orient qu’en Ukraine. Le pape François s’est, bel et bien, prononcé contre la guerre et a également réaffirmé l’importance de construire la paix et la coexistence entre les personnes de confessions différentes. À l’exception de sa contribution au dégel des relations entre Cuba et les États-Unis en 2015, la participation du Vatican est restée beaucoup plus discrète face aux questions les plus conflictuelles, car la coopération du Saint-Siège ne s’est pas étendue aux domaines de la médiation et de la négociation internationale.
Entre restructuration et rayonnement
François s’est davantage préoccupé de restaurer la crédibilité de l’Église et d’étendre sa portée dans les pays où l’image et la reconnaissance du catholicisme s’étaient affaiblies ainsi que dans ceux où l’Église catholique manquait tout simplement de représentation, comme ce fut le cas en Chine jusqu’en 2018.
En tant que premier pape latino-américain, François, au-delà de ses appels à la libération des prisonniers politiques et à la fin de la violence dans les pays totalitaires comme Cuba, le Venezuela et le Nicaragua, n’a jamais appelé le nonce apostolique accrédité dans ces pays pour des consultations, en particulier à la lumière des attaques que l’Église catholique a subies en raison de sa position critique sur les violations des droits de l’homme. Il n’a pas non plus visité son pays d’origine, l’Argentine.
En conclusion, le pape François a mis en œuvre un processus de restructuration interne et de réunification de l’Église catholique, et cela a été positivement apprécié par la communauté internationale. François pensait probablement que l’Église, même sous sa direction, pouvait difficilement intervenir directement dans les questions géopolitiques les plus importantes sans d’abord purger les vices et les contradictions existant au sein de la hiérarchie de l’Église.
Cela explique peut-être pourquoi le choix de son successeur sera marqué par la division qui persiste encore entre les secteurs qui défendent son héritage et ceux qui sont plus traditionnels et conservateurs. À cet égard, certains sondages d’opinion estiment que le cardinal italien et secrétaire d’État du Saint-Siège, Pietro Parolin, serait une figure de consensus capable de réconcilier les deux parties, en maintenant vivants les espoirs de 1,4 milliard de catholiques dans le monde à l’égard d’une Église encore emprunte à de nombreux défis à relever.