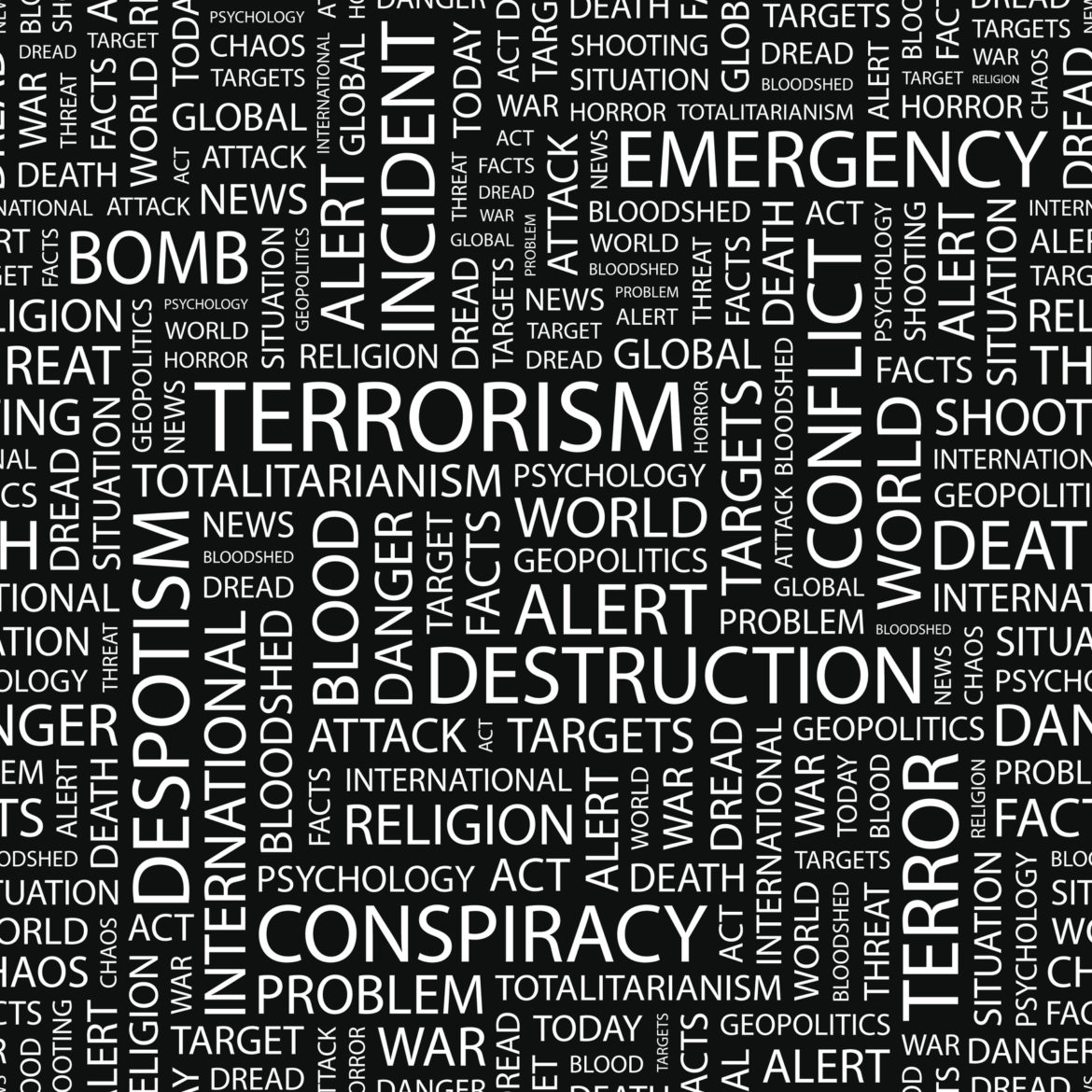L’essor de la modernité, contrairement à toute prévision, a mis à nu un monde en désordre, sans défense et bien plus exposé. Nous traversons un contexte de mutations sociales continues qui ont engendré un état d’insécurité collective et exacerbé les rivalités politiques, économiques et culturelles.
Le dialogue, la diplomatie et la négociation constituent aujourd’hui des règles d’exception face à l’exercice d’une antipolitique qui recourt à la menace économique et militaire. Mais la résurgence du populisme radical est également devenue un instrument catalyseur de la polarisation et de l’instabilité politique.
Des États criminels défient l’ordre juridique international, définissant de nouvelles alliances géopolitiques qui érodent le multilatéralisme et la paix mondiale. Il s’agit sans aucun doute de la construction d’une mondialisation parallèle et anarchiste qui cherche à démanteler l’ordre civilisationnel, à saper les institutions démocratiques et à nier le caractère universel des droits humains.
À quoi sommes-nous confrontés ?
La prolifération des armes nucléaires
La course aux armements est devenue le plus grand défi géopolitique en matière de sécurité ces dernières années. La violation systématique du droit international a révélé une diminution dangereuse des engagements pris dans le cadre du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) de 1968. Ainsi, la volonté politique en matière de non-prolifération doit avoir un caractère exceptionnel qui devrait contribuer à la dissuasion et à l’interdiction, et non à l’augmentation de l’accessibilité à l’armement ou au renforcement des centrales nucléaires.
Le terrorisme et le crime organisé transnational
Le terrorisme constitue la menace la plus imperceptible du monde contemporain depuis les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis et l’Occident. En tant que forme de guerre asymétrique, il ne possède pas de définition juridique reconnue, ce qui a limité le consensus international sur les mécanismes légaux pour y faire face. Mais les conflits et l’extrémisme religieux ont contribué à intensifier les attaques terroristes, dessinant un climat de violence interminable et insoutenable, qui a en outre favorisé les cyberguerres. De la même façon, les organisations criminelles, les groupes terroristes et les cartels du narcotrafic ont réussi à accroître leur protection grâce à leurs liens politiques. Cette dynamique rend la paix et la sécurité internationales plus vulnérables, puisqu’il n’existe pas d’instruments internationaux efficaces pour les combattre. Cela implique sans aucun doute d’entreprendre une révision et une mise à jour urgente du droit international, mais cela n’interdit à aucun État de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa sécurité et celle de ses citoyens. Lorsque ces structures criminelles s’ancrent dans le pouvoir politique, le pays concerné est soumis à un gouvernement qui exerce un terrorisme d’État avec impunité pour attenter à la sécurité et à la souveraineté d’autres pays.
Les radicalismes du XXIᵉ siècle
La radicalisation a réussi à s’imposer fermement depuis plus de deux décennies, en profitant des rails de la démocratie ou de l’usage de la force pour accéder au pouvoir avec des intentions clairement hégémoniques et totalitaires. Les niveaux d’intolérance idéologique ont donné lieu à de nouvelles formes de violence politique, qui promeuvent la haine, le crime, la répression, la censure, la division des classes sociales et la violation des droits humains.
Les migrations incontrôlées
Il n’y a pas si longtemps, les migrants étaient perçus comme des personnes qui, pour diverses raisons, quittaient leur pays d’origine à la recherche de sécurité et d’une meilleure qualité de vie. Ces motivations s’inscrivent dans le cadre du droit international humanitaire. Les migrations du début du XXᵉ siècle (Nord-Sud) avaient contribué au développement de nombreux pays en apportant une main-d’œuvre qualifiée et une expertise professionnelle. Cependant, l’augmentation de la violence et des conflits, conjuguée aux inégalités ainsi qu’aux risques climatiques et sanitaires, a rapidement modifié la perception et l’origine des flux migratoires.
En effet, au cours des 15 dernières années, les déplacements se sont multipliés massivement, entraînant des conséquences économiques et sociales complexes, notamment pour la sécurité des pays d’accueil. Cela s’explique surtout par le fait que la vague migratoire a basculé drastiquement du Sud vers le Nord dans la majorité des cas, et dans d’autres du Sud vers le Sud. Lorsque ces mouvements se produisent de manière rapide et disproportionnée, les systèmes de contrôle migratoire sont débordés, car historiquement les lois prévoyaient des mécanismes flexibles et parfois allégés pour vérifier les profils migratoires et la justification des demandes d’asile.
Avec l’aggravation des indices d’insécurité, ces procédures légales ont été réformées, donnant lieu à de nouveaux instruments tels que le Pacte sur la migration et l’asile de l’Union européenne, et dans des cas plus extrêmes, à la suspension récente du TPS et de différents visas pour migrants aux États-Unis. Il n’est pas moins important d’indiquer que la méfiance actuelle envers le phénomène migratoire obéit également à la distorsion du concept de multiculturalité face à une stratégie qui défie l’intégration dans les pays d’accueil.
Les campagnes de haine, de fraude et de désinformation permanente
Nous sommes confrontés à la tromperie, aux tentatives d’escroquerie et à la manipulation médiatique depuis notre téléphone portable jusqu’aux ordinateurs ou la télévision. Les médias traditionnels sont également des victimes directes ou indirectes. Les nombreux agents de la désinformation travaillent précisément à promouvoir le chaos, la confusion et le crime. Sous le couvert de la liberté d’expression, la voracité des connexions sans surveillance a créé une atmosphère dépourvue de régulations éthiques et de sécurité pour l’utilisateur. Les menaces intelligentes ne peuvent plus continuer à devancer la loi. C’est pourquoi plusieurs parlements ont déjà entrepris des initiatives nationales visant à établir une législation sur les communications et l’information de manière plus fiable et plus sûre.
Conclusion
Comme le décrit bien Pascal Boniface, « La géopolitique n’est plus réservée aux spécialistes, elle touche au quotidien le grand public ». Cependant, pour ceux d’entre nous qui s’inquiètent davantage de ce qui se passe dans le monde, la géopolitique ne peut plus dépendre d’un vieux système international qui refuse de comprendre que, pour renforcer le multilatéralisme, il faut d’abord se renouveler. Il est inconcevable de protéger notre paix et notre sécurité tant qu’il existe un état de désobéissance flagrante au droit international. Mais ce n’est pas une tâche exclusive des agents diplomatiques. Il revient à la société civile de s’organiser, et surtout à la jeunesse d’impulser, depuis les universités, les académies, les partis politiques, les associations et le secteur privé, les changements et transformations dont a besoin un système international en permanence attaqué et soumis aux dynamiques de la nouvelle géométrie du pouvoir.